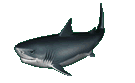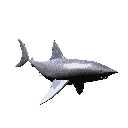

Paroles de Mathieu TilquinVoici le texte de Mathieu Tilquin La mer à deux pas Il paraît qu’il était un pionnier de la plongée sous-marine. Il paraît qu’il pouvait danser avec les poissons, ou en harponner presque cent kilos en une matinée. Il paraît qu’il a navigué sur l’un des bateaux les plus célèbres du monde et nagé dans toutes les mers. Mais moi, je ne l’ai jamais vu se baigner. D’aussi loin que je me souvienne, je vois un vieil homme à la silhouette mince et souple, au regard d’eau translucide noyé derrière des verres épais comme des hublots de sous-marin, à la voix posée et légèrement chantante. Marchant pieds nus, été comme hiver, dans d’éternelles tongs dont il me semble que j’entends encore le claquement régulier derrière sa maison, lorsqu’il suivait la pente douce bétonnée qui menait à sa chambre sous les amandiers, son antre, comme nous l’appelions. Une pièce ouverte au ras du sol de son jardin, dans laquelle il paraît qu’il a écrit plein de livres sur sa vie de plongeur. Cet endroit dont je sens encore l’odeur fraîche de terre et de vieux papiers, où j’adorais venir, petit garçon, pour qu’il me montre ses trésors : des petits objets collectés tout au long de ses aventures, sans doute les plus précieux, du moins aimais-je le croire, gardés dans une boite en bois ordinaire qui tenait toute sa beauté dans la façon qu’il avait de l’ouvrir, avec lenteur, avec respect, avec la patine de ses mains sèches et usées. Ces petits objets avaient une utilité ou non, une valeur ou pas, mais ils avaient tous une histoire qu’il me racontait en les sortant un par un : la dent de requin tigre, orpheline de ses centaines de sœurs, mais encore capable de découper d’un trait – démonstration à l’appui – une bonne épaisseur de feuilles d’annuaire ; la petite agate verte, translucide, ramassée dans les eaux froides du lac Titicaca ; la douille en cuivre d’une balle dum-dum qui avait dû volatiliser des kilos de chair sur le dos d’un malheureux cachalot ; la branche de corail noir, rugueuse, qu’on transforme en un magnifique bijou si on la polit patiemment avec un papier à carrosserie de plus en plus fin, et même le petit tube en verre fermé d’un bouchon en caoutchouc qu’il utilisait pour conserver bien au sec l’unique cigarette qu’il fumait encore le soir. J’ai connu la mer avec lui et l’ai aimée sans que jamais il ne m’y emmène, alors qu’elle était à deux pas de la maison. Je l’ai connue à travers ces objets, ces histoires pleines de sensations de plongeur qu’il racontait en faisant rouler un fond de whisky sur son palais : l’angoisse dans la cage aux requins, qui venait bien moins des squales surexcités passant à travers les barreaux que de la profondeur qui l’aurait englouti d’un coup » si le câble pétait » ; l’air confiné du caisson de décompression, » si épais que tu le sens dans ta main, et qu’il faut forcer pour l’inspirer » ; la corde rassurante que l’on suit avec confiance pour rejoindre la surface après une plongée longue ; la corde inquiétante que la mer avale sans fin au mouillage juste avant une plongée profonde ; et cette impression d’envie de pisser qui nous prend, » Coquin de Dieu » , lorsqu’on remonte à la surface après être resté quelques temps au fond – la seule expérience que j’ai pu vivre en vrai. Lorsque je suis allé plonger pour la première fois, il m’a amené à son établi et avec un couteau à greffer il a raccourci mon tuba en expliquant : » Un tuba, ça se coupe au raz du crâne, autrement tu t’époumones à le vider de son eau, et puis tu t’intoxiques avec ton propre gaz carbonique « . Je dois toujours avoir ce tuba quelque part dans la maison de Sanary, avec de vieux masques rongés par le sel, ce tuba coupé si court que je pensais boire mille fois la tasse en l’utilisant par temps de houle… Mais non, car en fait : » tu flottes à la surface, tu la suis, la houle ! « . Je me rappelle son sourire aussi. Un sourire malicieux lorsque pour expliquer sa légère surdité, il préférait incriminer de » trop nombreuses plongées acrobatiques » plutôt que son âge avancé ! Un sourire réjoui et tendre lorsque nous ouvrions fébrilement le coffre à jouets du salon, quand nous accourions pour écouter les chansons de Perret ou Brassens qu’il nous passait sur le tourne-disques, ou pour engloutir les fruits de son jardin. Il a si bien rempli sa vie professionnelle que 100 ans après sa naissance on parle encore de lui, Frédéric Dumas, l’un des trois célèbres Mousquemer. Mais cet homme-là je le connais mal. Car je dois l’avouer, de lui je n’ai rien lu que les quelques lignes d’une dédicace, celle qu’il écrivit sur la page de garde des » Chimères de la mer « , son livre qui parut presque un an après moi : » A Mathieu mon merveilleux petit fils, Pour qu’il partage un jour les plaisirs qui m’occupaient avant la joie si bonne d’être son papet. Avec tout plein de gros bisous. » F Dumas. 5 Février 1976
Frédéric Dumas et ses petits enfants. Mathieu est en haut, à droite. Coll. privée. |