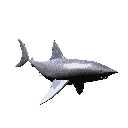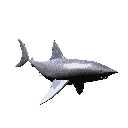« Au fil de l’histoire » par
Jean-Pierre Durand
Jean-Pierre Durand
a offert au musée de Sanary de nombreuses pièces
dont l’histoire vous est contée par lui dans les
pages ci-dessous. Matériel photo inventé ou
modifié, montages de bouteilles improbables et
reconstitution des détendeurs de la Spiro. Le fonds
Jean-Pierre-Durand est conséquent et homogène
du fait de son histoire. Jean-Pierre Durand est un des
« bricoleurs de génie » dont
s’honore l’aventure sous-marine et le musée
Frédéric-Dumas.
Voici un éléments historique
concernant le bi bouteille: « La
semaine dernière j’ai fait un saut dans ma famille
et en passant à Pézenas j’ai découvert
que la route qui pénètre en ville porte le nom de
l’aviateur allié abattu en 1944 dans les environs.
C’est avec les bouteilles d’oxygène de
son avion que j’ai construit, en son temps, mes premiers
scaphandres autonomes. Ci-joint photo de la plaque de rue. J’ai
pensé que ça pouvait vous
intéresser. »
Amicalement
Jean-Pierre
Durand
et voici la photo:

Le bi bouteille avec la copie du CG45 est
actuellement exposé au musée. En sorte désormais
d’hommage à cet aviateur. Photo Jean-Pierre Durand.
« Au fil
de l’histoire » par Jean-Pierre Durand
1950 – J’étais
au lycée en classe de troisième lorsque j’ai
vu pour la première fois au Cap d’Agde un chasseur
sous-marin équipé d’un masque et d’un
tuba .Comme je n’avais pas les moyens de m’acheter
ce matériel j’ai fabriqué un masque avec une
chambre à air de voiture et un tuba avec un morceau de
tuyau en caoutchouc tenu courbé avec une corde à
piano .(A ce jour le masque a disparu et il ne reste plus qu’une
partie du tuba .)

Le « bout » du tuba de
Jean-Pierre Durand. Coll. musée Frédéric-Dumas.
Don Jean-Pierre Durand.
1951- Mon père exploitait
une propriété viticole et utilisait un compresseur
Luchard H10 pour produire de l’air comprimé destiné
à pulvériser du sulfate de cuivre sur les
vignes. Mon frère aîné me disait « Nous
avons de l’air comprimé à notre disposition,
il nous manque un scaphandre comme le Cousteau-Gagnan .Cet
appareil permet de respirer sous l’eau en délivrant
de l’air à la pression de l’eau au niveau du
plongeur. Comme son prix est inabordable pour nous, il faudrait
en fabriquer un, mais comment ? » Au lycée
j’avais appris le principe de la pression hydrostatique,
mais je me demandais comment ouvrir un clapet d’air avec le
faible effort donné par une membrane en caoutchouc.
1953- En classe de terminale, à
cette époque, on étudiait la machine à
vapeur et j’ai alors pensé que le tiroir de
distribution de vapeur pouvait très bien distribuer de
l’air et faire office de clapet pour le détendeur.
En faisant arriver l’air par des trous égaux et
diamétralement opposés dans le cylindre du
distributeur , il n’y avait pas d’effet de plaquage
du piston sur la paroi du cylindre et aucun effort n’était
nécessaire pour le déplacer donc pour ouvrir
l’arrivée d’air . Il suffisait alors de
construire.
Un ami tourneur a tiré d’une barre de
laiton un petit cylindre et son piston associé et j’ai
fabriqué la « casserole » du
détendeur avec de la tôle de cuivre prélevée
sur une ancienne sulfateuse mise au rebut , le tout soudé
à l’étain . La membrane du détendeur a
été découpée dans une chambre à
air de voiture et la liaison entre la membrane et le piston
réalisée avec un rayon de roue de bicyclette. Le
bec de canard a été fait avec le caoutchouc fin
d’une vessie de ballon de football. Des tuyaux en
caoutchouc lisses assuraient la liaison entre détendeur et
embout.
Les premiers essais ont été réalisés
sur la plage du gros d’Agde, sous forme de « narguilé » :
Une bouteille d’air comprimé en surface avec
manodétendeur (utilisés pour les sulfatages des
vignes), un tuyau flexible alimentant le détendeur à
piston.
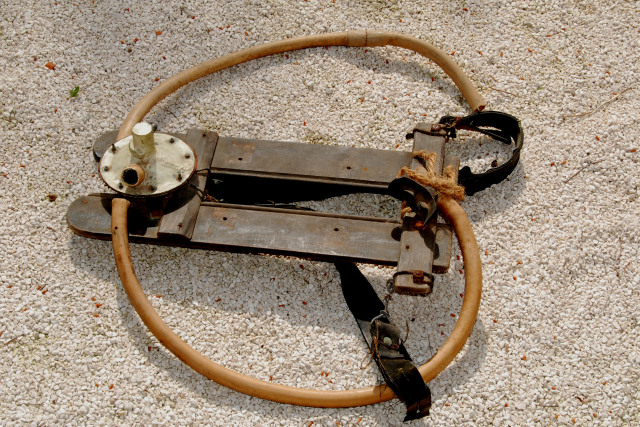
Voici le second narguillé réalisé
par Jean-Pierre Durand (le premier étant réduit à
l’état proche du néant). Celui-là est
visible au musée Salle Maurice-Fargues. Don Jean-Pierre
Durand.
« Les essais ayant été
déclarés concluants on a décidé de
passer au système autonome :
Nos bouteilles d’air comprimé pour le
sulfatage étant trop lourdes il a fallu trouver autre
chose. C’est chez un ferrailleur de Pézénas
que nous avons déniché notre bonheur : Des
bouteilles d’oxygène de 6,6 litres provenant d’un
avion anglais abattu dans la région par la DCA à la
fin de la guerre. Après avoir fait éprouver ces
bouteilles , j’ai pu constituer un bloc de deux et un bloc
de trois bouteilles ( Deux et trois mètre cubes à
150 bars).
Un ami plombier m’a donné un vieux
détendeur de soudage qui, après remise en état,
m’a servi de premier étage pour mon détendeur
à piston.
C’est ainsi que j’ai pu plonger en
scaphandre autonome dés l’été 1954″
1954-1956- « A la
distribution des prix en juillet 54 (ça se pratiquait à
cette époque), j’ai reçu « Le
monde du silence » de JY Cousteau et F Dumas et ça
m’a ouvert des horizons nouveaux pour les détendeurs
et la photo. C’est alors que j’ai construit mon
premier détendeur à deux étages monobloc en
utilisant le détendeur de soudage cité ci-dessus
mais en l’intégrant à la casserole du second
étage toujours réalisée avec la tôle
de cuivre de la vieille sulfateuse et le tout soudé à
l’étain. Les tuyaux annelés provenaient de
systèmes d’alimentation en gaz de moteurs de
voitures.
J’ai eu en main un « mistral »
prêté par un ami et sans vergogne j’ai
construit deux répliques adaptées à mon
système de raccordement d’air comprimé à
gros écrous, toujours avec les moyens du bord. J’avais
donc trois détendeurs (un à deux étages et
deux à un seul étage) et plusieurs blocs de
bouteilles de deux et trois mètres cubes : les portes
de la plongée nous étaient grandes ouvertes.
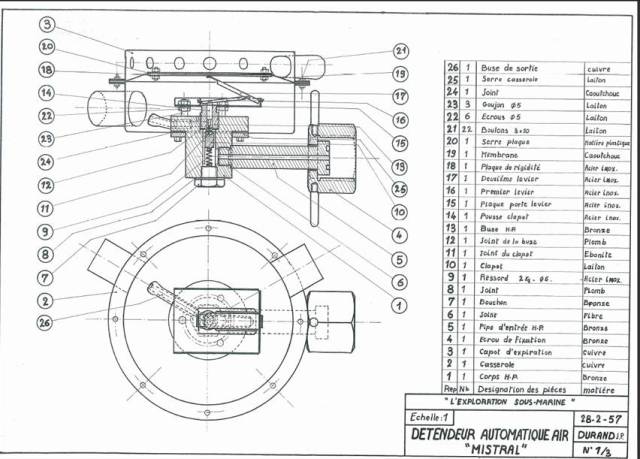
Le détendeur « Mistral »
de la Spirotechnique (1955). Plans dressés par Jean-Pierre
Durand. Planche 1.

Le détendeur « Mistral »
de la Spirotechnique (1955). Plans dressés par Jean-Pierre
Durand. Planche 2
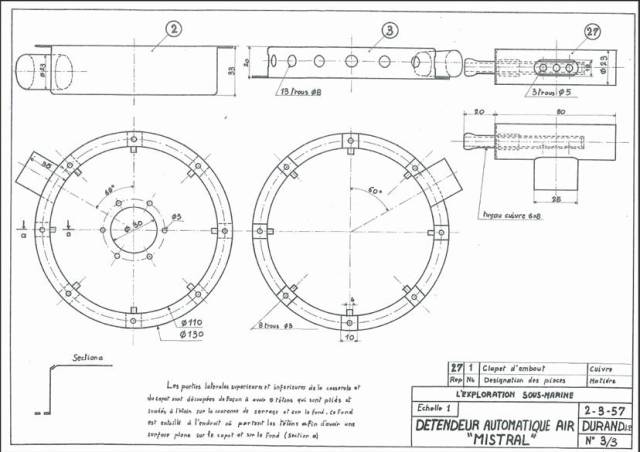
Notons que ces trois planches nous ont été
transmises par Jacques Chabert de Cap d’Agde qui les tenait
de Jean-Pierre Durand!
Quelques années plus tard j’ai
abandonné les bouteilles d’oxygène qui
étaient frétées avec un fil d’acier
que je n’arrivais pas à protéger correctement
de la corrosion.
J’ai adopté des bouteilles
« Brunon-Valette » de même capacité
et plus allongées ce qui n’était que mieux
pour l’hydrodynamisme. » Les
voici:

Bi bouteilles Brunon-Valette N°INV
2011.3.1(avant restauration) avec détendeur « bricolé »
à partir d’un modèle du commerce: le Mistral
de la Spirotechnique. Coll musée Frédéric-Dumas.
Donation Jean-Pierre Durand.

Second bi bouteilles Brunon-Valette N°INV
2011.4.1 (avant restauration) avec détendeur
« maison ». Ce sont donc 2 bi bouteilles et
deux copies du Mistral qui enrichissent les collections du
musées. Coll. musée Frédéric-Dumas.
Donation Jean-Pierre Durand.

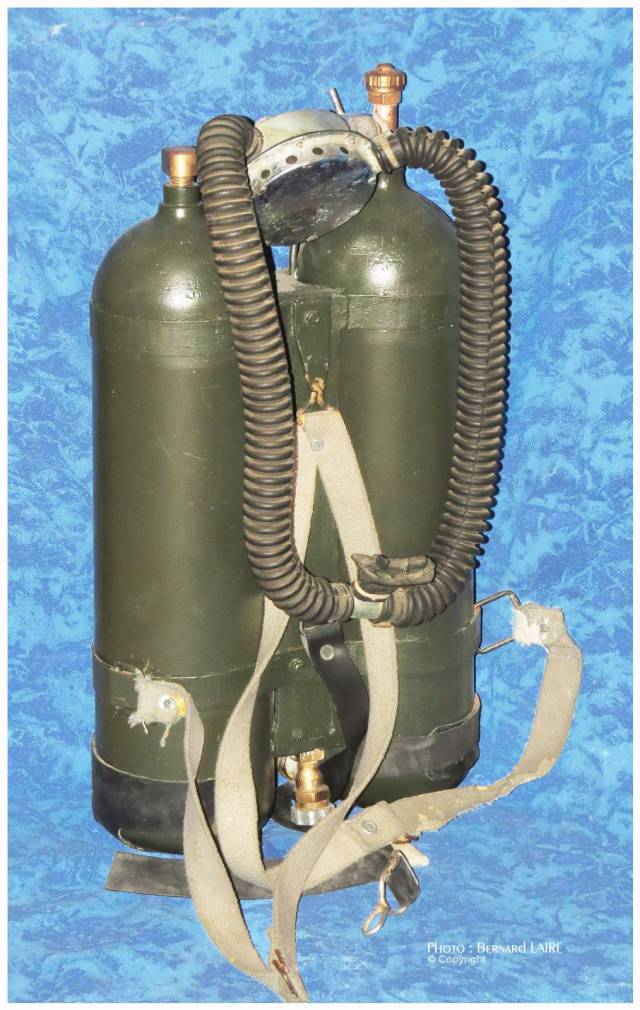
Le même.
Un des deux bi bouteille avec son détendeur
construit par Jean-Pierre Durand est en exposition permanente au
musée (salle Maurice-Fargues). L’un et l’autre
ont été vu à Paris (Salon international de
la plongée), à Marseille en 2012 et 2013 au
Festival mondial de l’image sous-marine, tout cet été
2013 à la Batterie du cap-Nègre de
Six-Fours-les-Plages et en cette année 2014 au Salon
de la plongée de Paris sur le stand
« Sanary-musée-plongée ». La
restauration des bouteilles a été réalisé
par Alain Chevalier alors
directeur de la SMR
Société Méditéranéenne de
Requalification, travail d’orfèvre ! Désormais
retraité il a cèdé la société
à ses deux associés Hervé Noël et
Philippe Rabiller, tout aussi attentifs au développement
du musée. SMR sponsor officiel du musée
Frédéric-Dumas héberge le site que vous êtes
en train de lire.
1955- Photographie et
cinéma
« Envie de rapporter des images de tout
ce que je voyais en plongée, d’où la mise en
boite d’appareils photo ou cinéma .
La première boite est destinée
à recevoir une « Rétinette »
kodak 24×36 .
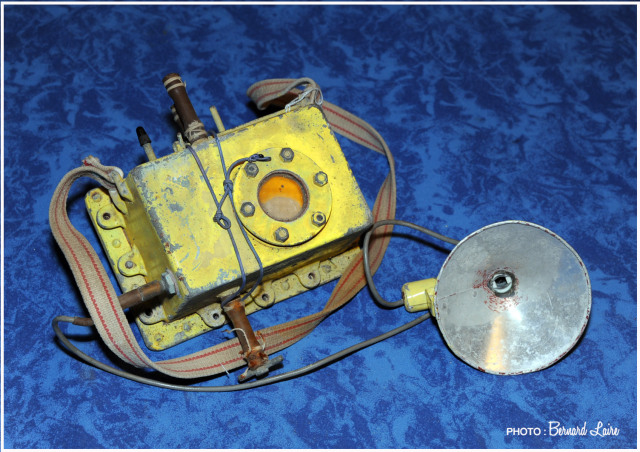
Boîtier étanche pour Kodak
Rétinette 24X36 avec flash réalisé en
1957. Exposé salle Maurice-Fargues.
Coll. musée Frédéric-Dumas. N°INV
2011.7.1 & sq. Don Jean-Pierre Durand
Cette boite est construite en tôle d’acier
de 3 mm d’épaisseur soudée à l’arc
et galvanisée à chaud. Les passages des commandes
sont étanchées pas des morceaux de tuyaux en
caoutchouc médical très souples. L’équilibrage
hydrostatique est assuré par une épaisse plaque de
liège.
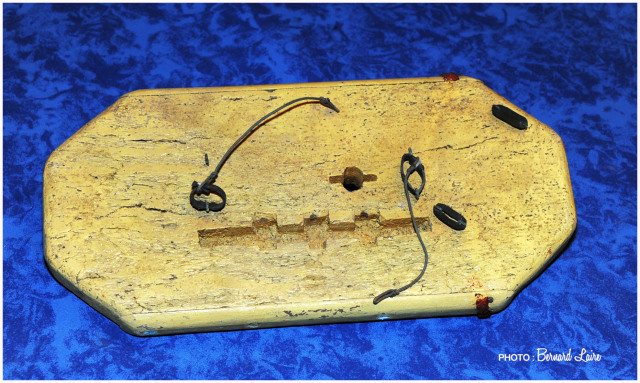
Le flotteur pour le caisson étanche
du caisson pour Rétinette Kodak
J’ai ensuite réalisé le caisson
étanche pour une caméra Eumig 8 mm
mécanique en utilisant la même technique
que pour le boîtier de l’appareil de photo.
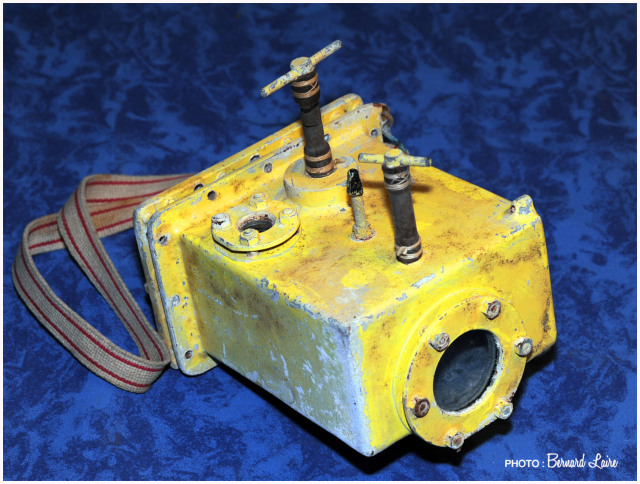
Caisson étanche pour caméra
Eumig 8mm mécanique réalisé en 1957 (ou
1958). Exposé salle Maurice-Fargues. Coll. musée
Frédéric-Dumas.N°INV 2011.13.1.1 & sq. Don
Jean-Pierre Durand.
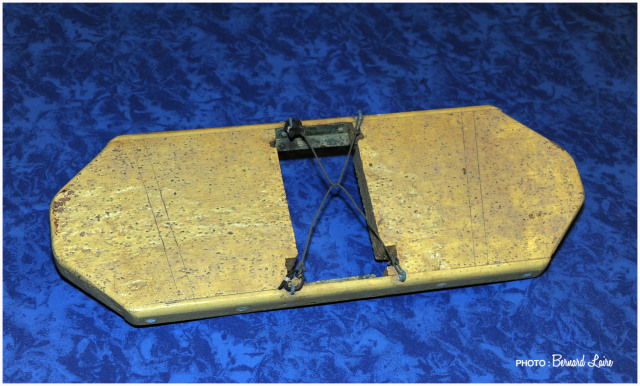
Le flotteur du caisson caméra Eumig.
Le musée présente l’ensemble complet.
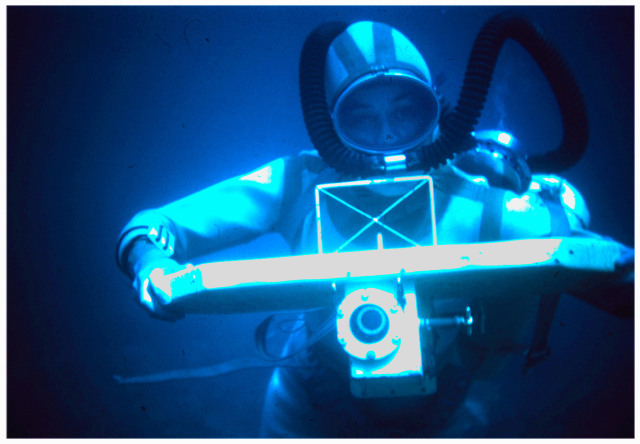
La caméra Eumig dans son boîtier
et…dans son élément. Photo prise par
Jean-Pierre Durand avec le Rétinette Kodak…dans son
boîtier. Coll. Jean-Pierre Durand.
Le cinéma me donnant de meilleures
satisfactions que la photo, j’ai abandonné un
certain temps la photo pour le cinéma jusqu’au jour
où j’ai installé un flash sur mon boîtier
photo. Il s’agit d’un flash à ampoules
magnésium à usage unique. Le corps du flash est
logé dans le boîtier de l’appareil photo et
les ampoules sont placées dans un réflecteur
installé sur un bras à l’extérieur du
boîtier. Le remplacement des ampoules se fait sous l’eau.
Là, devant la beauté des photos obtenues grâce
à l’éclairage du flash, j’ai abandonné
le cinéma qui me donnait des images à dominante
bleu. »
L’ensemble monté tel que nous le
voyons au musée:

L’ensemble caisson, flotteur, flash
pour « Rétinette » Kodak. Conception
et réalisation Jean-Pierre Durand. Coll musée.
Donation Jean-Pierre Durand.
1961-
Trombinoscope
Cette année-là, j’ai eu
l’occasion d’aller sur les bords de la Mer Rouge à
Eilat en Israël et devant l’impossibilité
d’emporter mes boîtiers étanches car trop
lourds et trop volumineux, j’ai fabriqué un
« trombinoscope »
de J.A. Stevens plus adapté aux exigences du voyage. Cet
ustensile est constitué d’un morceau de chambre à
air de voiture fermé à une extrémité
par un hublot en verre et de l’autre par un gant en
caoutchouc. Contre le hublot une équerre en alu permet de
fixer l’appareil photo ou la caméra. Il suffit
d’introduire la main dans le gant pour avoir accès
aux commandes de l’appareil. Bien sûr on ne peut
descendre qu’à quelques mètres sous l’eau
mais c’est toujours mieux que rien.

Le trombinoscope reconstitué par
Jean-Pierre Durand pour le musée Frédéric-Dumas
et actuellement exposé salle Maurice-Fargues.

Les premiers « caissons »
en caoutchouc étaient bien sûr étanches et
fermés, il fallait -en tenant compte de la pression-
manipuler les commandes de l’appareil de prise de vues par
l’extérieur. (voir l’article sur Pierre
Mongeot). Ici le système développé par J. Y.
Stevens pour son Plastiphot repose sur l’insertion
d’un gant de ménage rétractable dont l’entrée
est cerclée à la place d’une vitre. C’est
donc un état technique intermédiare, il est
cependnat plus simple que le « Plastiphot ».

Avec l’appareil photo. Le
trombinoscope et l’appareil de prise de vues sont exposés
salle Maurice-Fargues. Coll musée
Frédéric-Dumas Donation Jean-Pierre Durand.
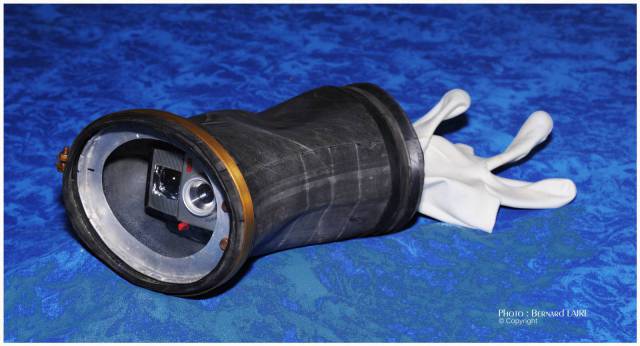
L’ensemble. Une partie de
l’original(verre cerclage et morceau de caoutchouc) est
exposé au musée avec le trombinoscope.
1962- Boîtier
« Tarzan »
Je récupère un vieux boîtier
« Tarzan » pour appareil photo FOCA
Standard à objectif de 35 mm ouvrant à f :
3,5. Pendant mon service militaire j’ai la chance d’avoir
accès à un atelier de mécanique et je
modifie entièrement le boîtier :
-Réfection des commandes avec étanchéité
par joints toriques.
-Ajout d’une commande de mise au point à
grand renfort d’engrenages de Meccano.
-Adaptation d’une lentille additionnelle
immergée et amovible pour prise de vues rapprochées.
-Ajout d’un viseur extérieur.
-Confection d’un flash magnésium
externe (Il n’y a pas de place dans le boîtier pour y
installer le flash)
-Modification des contacts de déclanchement
du flash, dans l’appareil photo, afin de pouvoir utiliser
la pleine puissance des lampes magnésium standard avec
l’obturateur à rideau au 1/50 de seconde.
-Confection d’un distributeur de lampes flash.
-Equilibrage de l’ensemble avec du liège.

Boîtier « Tarzan »
de Beuchat Marseille (pour appareil Foca réplique du
Leica) revisité par Jean-Pierre Durand (1962).
Coll musée Frédéric-Dumas. N°INV
2011.8.1.2 & sq. Photo Jean-Pierre Durand.
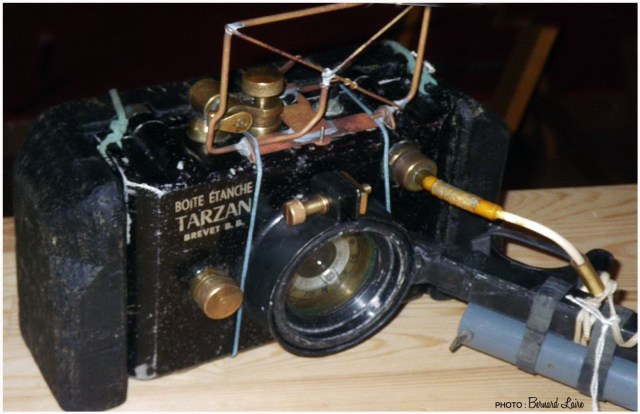
Où l’on voit les modifications
apportées ainsi que l’adjonction de blocs de liège.
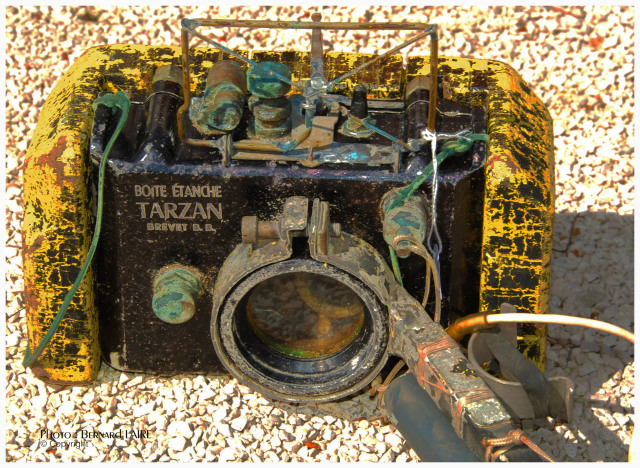
Avant de faire sa donation Jean-Pierre
Durand avait soigneusement restauré son matériel.
On mesure avec cette photo le travail accompli. Photo Jean-Pierre
Durand.

le flash avec son tube réservoir
d’ampoule à débit automatique. Photo
Jean-Pierre Durand
l

Bras du flash pour le caisson « Tarzan »
Beuchat. Luxe: la réserve d’ampoules logé le
long du bras. A chaque usage une nouvelle ampoule apparaît
(jusqu’à épuisement du stock ! ). Au premier
plan remarquons la lentille additionnelle pour macro photo.

Où l’on voit les systèmes
de transmission des commandes. Photo Jean-Pierre Durand

L’intérieur du boîtier
« Tarzan » de Beuchat revisté par
Jean-Pierre Durand. Quant à l’appareil photo son
constructeur d’origine ne le reconnaîtrait plus.
Coll. musée Frédéric-Dumas. Don Jean-Pierre
Durand.

Le boîtier « Tarzan »
ouvert. Il s’agit ici d’une photo envoyée par
un collectionneur US qui nous demandait les références
de nos boîtiers « Tarzan ».
L’intérieur du boîtier « Durand »
est beaucoup plus complexe!

La boîte de transport du matos. Photo
Jean-Pierre Durand. (les boîtes de transport des matériels
photo de Jean-Pierre Durand font également partie des
fonds du musée)
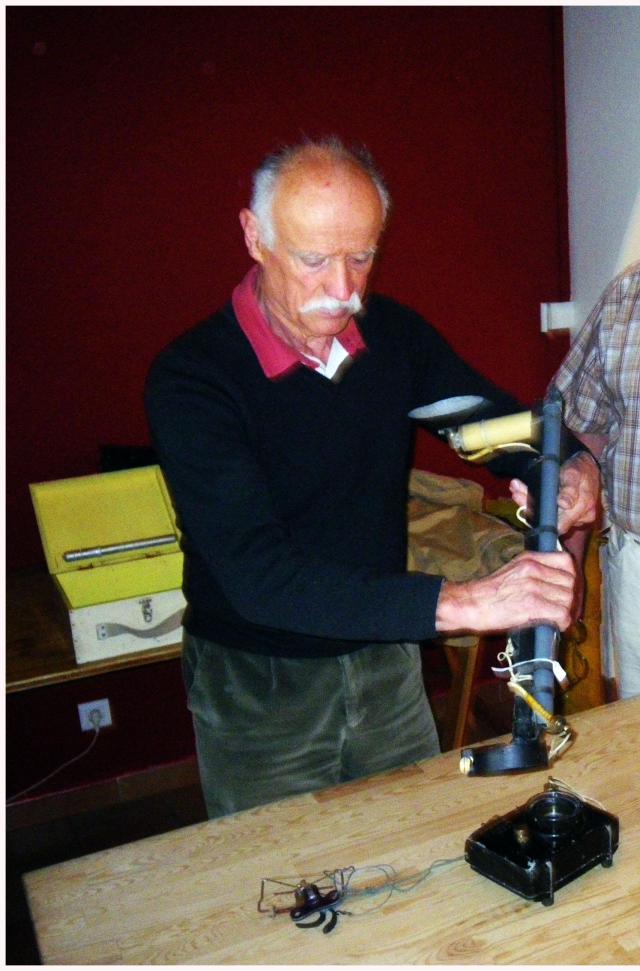
Jean-Pierre Durand. Photo Bernard Laire.
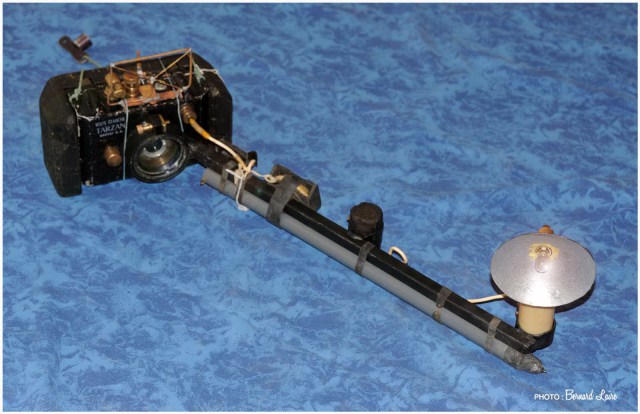
Ensemble de prise de vues sous-marines.
Photo prise pour l’inventaire lors de la donation. Cet
ensemble est exposé salle Maurice-Fargues. Coll musée
Frédéric-Dumas. Donation Jean-Pierre Durand.
Photographe de l’inventaire: Bernard Laire.
Jean-Pierre Durand nous a prêté une
série de que Bernard Laire à reproduites.
Voici deux autres objets inclus dans la donation
faite par Jean-Pierre Durand:
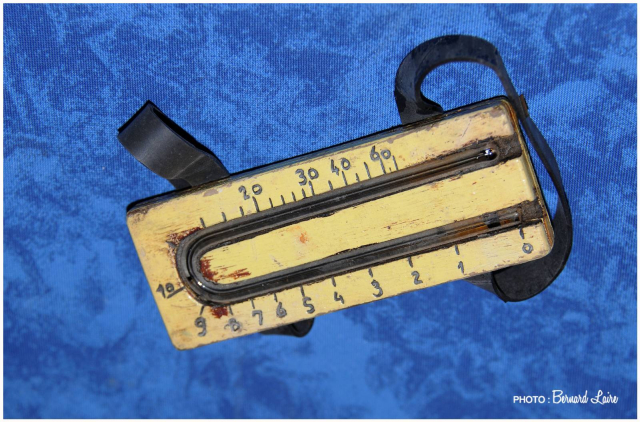
Profondimètre réalisé
par Jean-Pierre Durand, élève assidu des cours de
physique. Coll musée Exposé au musée. N°INV
2011.21.1. Don Jean-Pierre Durand.
et

Planche traineau aquatique réalisée
par Jean-Pierre Durand. Vue tout l’été 2013 à
la batterie du Cap Nègre de Six-Fours les Plages. Coll
musée. Don Jean-Pierre Durand.
1964- Eclairage sous marin
Construction d’un projecteur 150w et d’un
caisson étanche pour une caméra Eumig 8 mm
automatique et électrique, puis en 1973 d’un caisson
pour caméra Canon 814 super 8. Le tout en PVC et
Plexiglas. Mais ça devient l’ère moderne……….
La Seyne le 26 février 2011
Vous souhaitez contacter Jean-Pierre Durand:
Jean-Pierre DURAND
709 Chemin d’Artaud à
Pignet
83500 LA SEYNE SUR MER
04 94 94 64 93
|